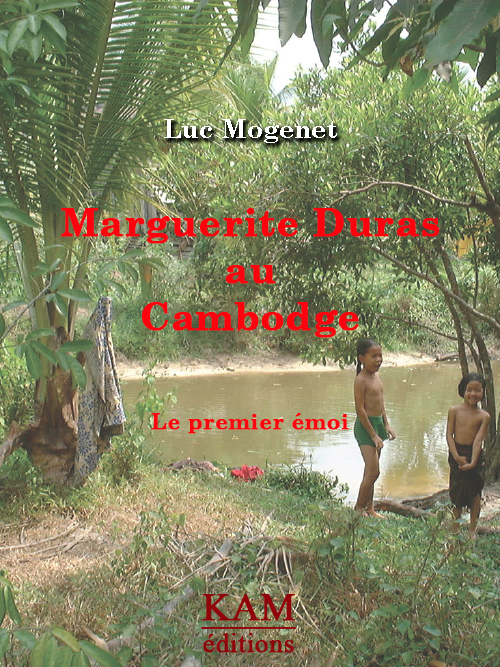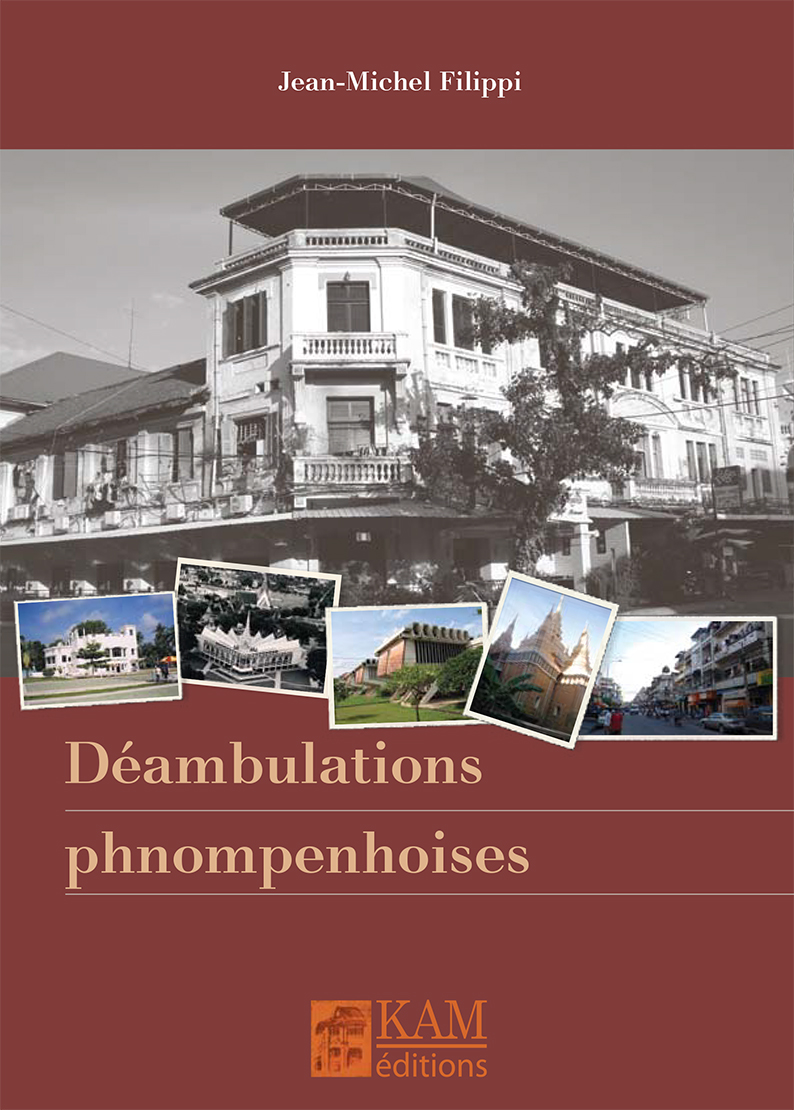L'américanisation sans remise en question
De près et de loin
Une culture au sens national du terme fait partie de ces abstractions auxquelles on fait sans arrêt référence sans être capable d’en donner une définition même imprécise. On ne sait d’ailleurs même pas ce qu’on doit ranger sous cette étiquette, va pour la musique et la littérature, mais les avis divergeront quant à l’inclusion des parfums et de l’alimentation. Une fois la question du contenu tranché généralement sur un mode implicite, un obstacle majeur demeure ; on a beau évoquer à satiété le concept de culture, il n’en demeure pas moins qu’un fait culturel quelconque ne relève pas d’une entité nationale mais reste soumis au moule des exceptions : différentiations sexuelles, de générations, sociales, géographiques, etc. Il y a fort à parier qu’à la fin il ne doit plus rester grand chose en guise de dénominateur commun.
L’anthropologie culturelle a pris la mesure du paradoxe et des auteurs comme Condominas ont fini par bannir le terme « culture » de leurs écrits pour l’éclater en divers concepts comme « l’espace social ».
La seule façon d’échapper au paradoxe est de prendre de la distance ; on ne verra pas la culture américaine en ayant le nez dedans aux Etats-Unis, par contre, de l’étranger, on pourra taxer d’américain un fait culturel quelconque. Comme toutes les cultures, la culture américaine sera avant tout un objet d’exportation modelé aux termes de négociations indécelables entre un pourvoyeur et un public. Cependant, une réserve notable s’impose en ce qu’on n’exporte pas n’importe quoi n’importe où : il y a de la distance des films de John Houston aux gesticulations simiesques sur les pistes de danse.
Les hauts et les bas
Une culture est généralement susceptible de différentes acceptions, comme en témoigne la notion de culture de masse. Une vision élitiste distinguera bien la culture au sens noble du terme des objets de consommation et reléguera ces derniers hors de la sphère culturelle. Les choses sont-elles pour autant aussi simples ?
Pendant des années, on a taxé produits et attitudes importées d’outre Atlantique de « sous culture américaine » et même de « non culture américaine » au terme d’un raisonnement avant tout idéologique où se rejoignaient extrême gauche et nouvelle droite. La culture « véritable » censée rester française était destinée à l’élite, on laissait à l’Amérique les « pains et les jeux ».
Ce n’est pas caricaturer que de voir les choses de cette façon ; le poids de la culture française en Asie a bien été réel et les restes sont éloquents : la Corée du Sud a beau être la quinzième puissance économique du monde, la présence de 60 départements universitaires de Français semble disproportionnée par rapport aux besoins du pays. Il en ressort l’opposition habituelle tellement facile entre une gratuité conçue comme noble et la bassesse de l’utilitarisme.
Cette vision dichotomique, basée sur une illusion d’optique, n’a plus aucun lieu d’être ; une révolution silencieuse qui a débuté dans les années 80 a doté l’Amérique d’un discours culturel destiné cette fois à être aussi exporté. Depuis, cette vision culturelle s’est étendue au monde entier et s’est imposée tant comme préalable à l’exercice général de la pensée que dans la conception des contenus universitaires.
L’Asie fascinée par un modèle culturel américain
Cette nouvelle vision culturelle américaine semble avoir trouvé un terrain des plus favorables en Asie. Comme point de départ à l’analyse, les contenus idéologiques de cette « culture » se laissent facilement cerner dans un cadre universitaire : les genders studies et les droits de l’homme.
Les genders studies ou études de genre posent comme préalable une différentiation basée sur le sexe pour rendre compte de l’ensemble des phénomènes sociaux. Pratiquement, il en résulte des rôles masculin et féminin qui, n’ayant rien d’inné, sont par définition sujet au changement.
Dans le deuxième cas, il s’agit d’une proposition d’évitement de toute entité supérieure à l’individu ; « homme » s’éloigne ici de la notion de personne et s’applique à l’individu stricto sensu.
Il ne faut pas être grand clerc pour concevoir l’effet déstabilisant que la généralisation de ces thèmes pourrait avoir sur une société asiatique traditionnelle. Dans le cas de l’Asie du Sud Est bouddhiste, on peut remarquer une vision sociale particulièrement hiératique dans l’organisation du cadre familial et supra familial : entre les générations, les sexes et les milieux sociaux. Ce sens de la hiérarchie était jusqu’à présent bien entretenu par l’éducation traditionnelle des pagodes conçue sur la base de récits et de dictons précisant à chacun place, droits et devoirs.
Une vision culturelle à l’américaine entraîne immédiatement deux faits : l’appréhension d’une société comme stratification d’hérésies, le fameux communautarisme américain, et l’accession de tout un chacun à la dignité d’individu, la société du tutoiement. Les deux se rejoignant parfaitement dans le rejet implicite du concept de hiérarchie comme soubassement social.
Et si l’Asie, bouddhiste ou confucéenne, finissait par se lasser d’une structure sociale pyramidale ? Ce modèle socio culturel américain pourrait parfaitement offrir l’armature idéologique recherchée. Les élites d’une Asie traditionnelle, Kishore Mahbubani en tête, en sont parfaitement conscientes comme le montre l’émergence des fameuses « Asian values » dans des contextes aussi différents que la Malaisie de Mahatir ou le Singapour de Lee Kwan You. La genèse et le développement de ces valeurs asiatiques, qui ont un temps même tenté les généraux birmans, s’expliquent avant tout comme une réaction à une occidentalisation dont les effets sont vus comme excessifs et / ou déstabilisants.
En quoi consisterait en l’occurrence la singularité du Cambodge ? Eh bien, pour les raisons bien connues de son histoire récente, le royaume offre tous les avantages de la page blanche où ces contenus pourront s’inscrire évidemment sans rencontrer de résistance, mais aussi et surtout sans qu’aucune critique ou remise en question ne s’exercent. D’autre part, ces contenus culturels expriment une ferveur particulière pour la notion de « société civile » ; ce concept dont on use et abuse doit se comprendre comme la volonté d’émergence d’une structure bien distincte et potentiellement concurrente du pouvoir d’état. En la matière on ne saurait trouver un terrain plus prometteur qu’un Cambodge idéologiquement bien préparé à ce genre d’idées par ses multiples ONG.
Jean-Michel Filippi