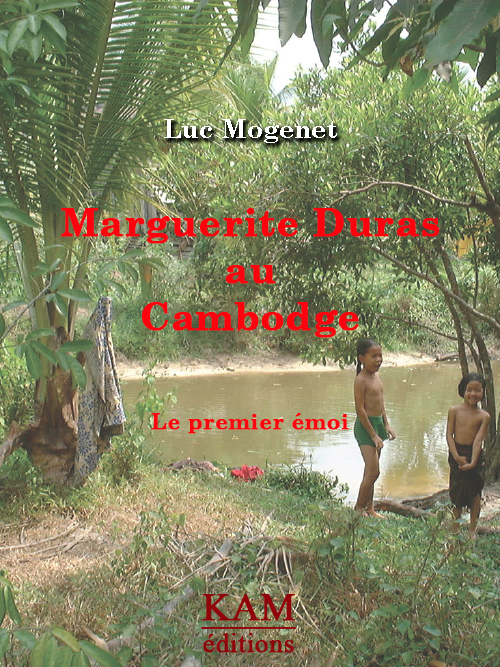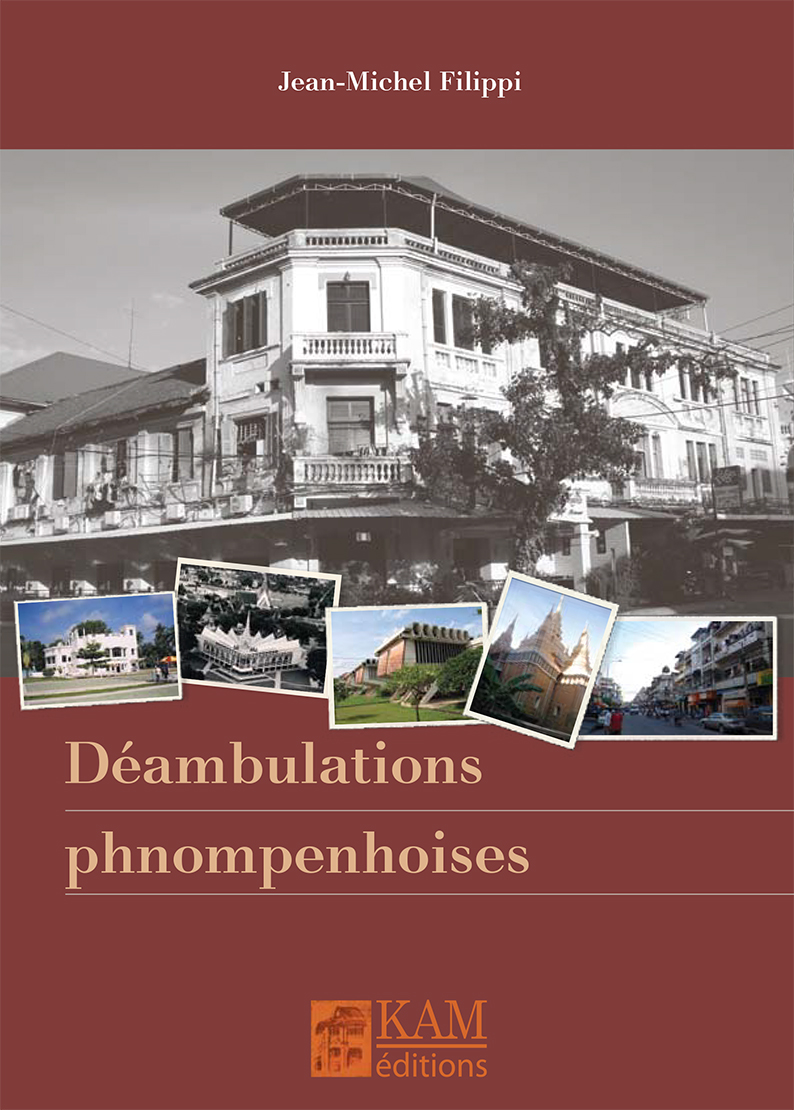Petite philosophie pratique de l’histoire du Cambodge (3/3)
Protectorat et culture politique dans le Cambodge moderne
Les paramètres et les poncifs se rencontrent dans toutes les constructions de l’histoire, quel que soit le pays considéré. Le rôle que le concept de « renaissance » a été appelé à jouer dans l’historiographie occidentale est révélateur, ainsi que l’est le traitement subséquent d’autres périodes, comme le Moyen-Âge à la dénomination des plus parlantes. Si la catégorisation est inévitable dans des ouvrages généraux d’histoire, ce n’est pas cela qui est en jeu ici.
Ce qui nous intéressera est plutôt la façon dont les paramètres explicatifs de l’histoire cambodgienne ont été mis en place et les raisons pour lesquelles ils l’ont été. Un autre point important est que l’écriture de l’histoire cambodgienne est essentiellement le fait d’étrangers ; se pose alors inévitablement la question de sa réappropriation par les Cambodgiens.
Le terme de protectorat ne veut pas dire grand chose ; le Tonkin, l’Annam et le Maroc ont bien été des protectorats français et pourtant les actions que la France y a effectuées n’ont rien à voir avec ce qui a été fait au Cambodge.
Les tractations qui vont aboutir à l’instauration du protectorat se déroulent en deux temps. Si le Cambodge fait initialement appel à la France pour récupérer les territoires perdus au profit des Siamois et des Vietnamiens, la situation s’est suffisamment dégradée en 1863 pour qu’il ne soit plus question que de « protection ». L’ambiguïté du terme est amplement démontrée par l’évolution ultérieure des rapports entre la royauté cambodgienne et les autorités protectorales.
Si l’appréciation de la situation du Cambodge en 1863 varie selon les historiens, il existe néanmoins un consensus sur le fait que ce qu’il restait du Cambodge aurait probablement disparu sans l’intervention de la France. L’exemple du grignotage du Champa par la Nam Tien (marche vietnamienne vers le sud) et sa disparition subséquente en tant qu’état a souvent servi de parallèle.
La protection d’un état et de ses prérogatives territoriales est une chose ; il pourrait par exemple s’agir d’une puissance étrangère qui décide, pour des raisons stratégiques ou autres, de garantir l’existence ou la survie d’un état contre des voisins qui souhaitent s’en emparer. Il peut aussi être question de garantir un état des lieux dans une région donnée et c’est ce qu’a fait la Chine en Asie du Sud Est pendant des siècles. Contrairement à une idée reçue, ce n’est pas tout à fait ce qu’a fait la France.
Pour la France de 1863, la problématique du protectorat ne se pose pas en des termes de conservation d’un statut quo. Certes, le Cambodge continue d’exister et les Français feront même mieux, avec le traité Franco siamois de 1907, en redonnant en grande pompe au Cambodge ses provinces perdues. Ce qui est pourtant essentiel est qu’il s’agit pour la France non pas d’un espace à conserver, mais d’un espace à créer. La question de savoir si la survie d’un espace cambodgien en Asie du Sud Est passe par la création d’un nouveau Cambodge ou si cette création est initialement conçue pour servir au mieux des intérêts coloniaux n’a ici pas beaucoup d’intérêt.
La réalité est que la France découvre une étendue cambodgienne qu’elle va s’employer à structurer en espace. La tâche, comme on peut constater a posteriori, a été immense et a notamment supposé une refonte des cadres éducatifs et religieux et, par dessus tout, la création d’une culture cambodgienne emblématique.
Le régime de protectorat n’est pas un simple trait d’union protecteur entre un avant et un après, mais l’acte fondateur d’une nation Cambodgienne moderne dont la culture politique et historique va être entièrement repensée ainsi que ses modes de transmission.
Deux points forts méritent d’être soulignés sur lesquels le protectorat va initialement agir : la reprise en main de l’éducation qui, apanage des pagodes, est considérée comme non scientifique et donc peu à même de former les Cambodgiens à participer pleinement à l’économie coloniale. La solution adoptée, le système des « écoles de pagode rénovées », présentait l’avantage de moderniser et d’uniformiser les cursus sans pour autant rompre avec le cadre de la pagode. Un deuxième point a consisté à réduire la mobilité des moines qui, au grand déplaisir des autorités, continuaient à se rendre au Siam dont le bouddhisme est, dans ses grandes lignes, très proche du bouddhisme khmer. Des mesures administratives pour réduire la liberté de mouvement des moines ont été adoptées, mais le point essentiel dans le processus de construction d’une religion nationale (sasna jiet) a été en 1930 l’Institut Bouddhique. Les enjeux étaient considérables et la sécularisation du Sangha (communauté des moines) a été la condition d’émergence d’une religion nationale ; dans ce cadre, l’Institut Bouddhique a été conçu comme un centre du bouddhisme Theravada dans l’Indochine française et qui permettrait d’autonomiser le Sangha khmer par rapport au Siam, voir à l’en séparer. Il ne s’agissait pas de voeux pieux et tout a été mis en oeuvre pour réaliser ce but : collecte de manuscrits, intense activité éditoriale, mise en place de la commission d’édition du Tripitaka ont concouru a créer l’armature d’un véritable bouddhisme national.
L’angkorianisme : recréation ou création
Il est tentant de parler d’une culture nationale qui résumerait de toute éternité les caractéristiques d’un peuple surtout quand l’emblème de cette culture s’offre sous l’aspect massif d’Angkor Vat que tous les drapeaux cambodgiens ont revendiqué depuis l’indépendance ; on sait très bien, par ailleurs, que les moindres remises en cause du lien entre la nation khmère et Angkor provoquent des réactions passionnelles.
Au moment de la « découverte » d’Angkor par Henri Mouhot, aux yeux des Cambodgiens de l’époque, le statut de l’édifice ne brille pas par sa clarté. Angkor était certes connu des Cambodgiens et diverses légendes en contaient les origines comme le montrent les nombreux témoignages recueillis par Mouhot. Cependant, comme l’a souligné Penny Edwards, « [les] Khmers qui vivaient dans le voisinage du temple n’identifiaient pas Angkor à un monument de la nation khmère ou à un réceptacle de l’orgueil national mais plutôt à un site religieux... ». Passer d’un lieu de culte vénéré au symbole d’une nation suppose une entreprise de désacralisation et c’est précisément l’oeuvre que le protectorat va accomplir.
La construction de l’historiographie angkorienne mobilise les contributions de l’archéologie et de la muséologie. A l’époque, la complexité de la construction se révèle dans les débats qui président à la représentation d’Angkor à l’exposition coloniale de Marseille en 1922 ainsi qu’à l’exposition coloniale internationale de Paris en 1931. Cette dernière exposition va tailler la part du lion à Angkor car, selon Penny Edwards, « Angkor a joué le rôle d’un signifiant crucial de la différence khmère. La mise en valeur par la France d’Angkor Vat comme emblème clé de l’Indochine a encouragé l’orgueil national khmer et a provoqué l’indignation vietnamienne ».
Séculariser et magnifier Angkor entraîne inévitablement le problème du rapport entre les Khmers de l’époque du protectorat et le monument. Dans la vision romantique initiale de l’explorateur, cette oeuvre grandiose est celle d’un peuple mystérieux qui a disparu sans laisser de traces ; mais la présence, en grand nombre, d’inscriptions en vieux khmer lève toute ambiguïté et on se rend très vite à l’évidence : ce sont bien les khmers qui sont à l’origine de ces monuments. Il allait falloir alors expliquer le lien entre un peuple considéré, à l’époque, comme dégénérescent et les vestiges d’une grande civilisation. Le discours du protectorat y a excellé sur le mode « grandeur et décadence des civilisations » mais aussi et surtout par une thèse sur la nécessité de sauver ce pauvre peuple de sa disparition, discours qui, il faut le dire, véhicule une mentalité d’assiégé. Les enjeux sont désormais clairs et la renaissance d’Angkor va de pair avec un sauvetage du peuple khmer, les deux assurés par l’entreprise du protectorat.
A force d’entendre le couplet « Angkor symbole de la civilisation khmère », on a fini par oublier le sens du mot symbole, le symbole est un signe qui ne présente pas de ressemblance avec l’objet qu’il dénote, contrairement au rapport que la fumée entretient avec le feu ou la tête de mort avec le danger... A ce titre, Angkor n’a jamais été symbole de quoi que ce soit, tout au plus centre de pouvoir à une époque donnée pour finir comme tombeau. Le protectorat crée l’équation Angkor – civilisation khmère qui autrement n’aurait jamais été posée. L’illusion de la réalité est une vieille banalité philosophique que rencontre tout potache en classe de philo, par contre l’exemple d’Angkor nous illustre à merveille une catégorie bien plus prometteuse : la réalité de l’illusion ; pour preuve un certain motif sur les drapeaux de tous les régimes qui ont succédé au protectorat.
Penny Edwards nous résume la situation cambodgienne par une formule frappante : « Au Cambodge, les nationalistes n’ont pas produit de culture nationale. C’est bien plutôt l’élaboration d’une culture nationale par des Français et des lettrés cambodgiens qui a fini par produire des nationalistes ».
De Angkor à l’Angkar
Le deuxième grand évènement marquant de l’histoire cambodgienne est évidemment le Kampuchéa Démocratique (KD). Le régime des khmers rouges a suffisamment marqué les imaginations occidentales pour qu’on l’analyse sous tous les angles possibles et imaginables : démographique, sociologique, historique, gender studies...En termes de quantité, l’abondante production écrite sur ce régime est en passe de faire concurrence à la littérature sur Angkor.
Là encore, on ne voit pas l’ombre d’une volonté cambodgienne à l’oeuvre, si ce n’est le choix d’une stratégie de l’oubli et pour cause, car il n’est pas particulièrement reluisant d’aller seriner à la face du monde que des Khmers ont massacré des Khmers et que le Cambodge a finalement été "libéré" par des Vietnamiens. Ce sont encore et toujours des étrangers qui vont se charger de l’écriture de l’histoire locale ; l’entreprise, culminant avec le procès, est d’une réussite initiale sans faille et il n’est pas inutile d’en rappeler les étapes. A partir de témoignages recueillis et transcrits dans les années 1980, Ben Kiernan va créer son « Cambodian Genocide Programme » à l’université de Yale en 1994 et, en janvier 1995, il sera l’artisan majeur de la mise en place à Phnom Penh du Documentation Center of Cambodia (DCCAM) qui fonctionne au départ comme l’annexe locale de l’université de Yale.
La consécration de ces efforts ne se fera pas attendre et en mars 1999 le secrétaire général des Nations Unies écrit : « Pendant les vingt dernières années, des tentatives diverses ont visé à rassembler les preuves des atrocités des Khmers rouges...Pendant près de vingt ans des universitaires ont accumulé de telles preuves en parlant avec les survivants et les acteurs de la terreur et en examinant des documents, des photographies ainsi que des charniers. A cet égard, l’initiative la plus organisée et impressionnante a été celle du DCCAM qui est établi à Phnom Penh. Originellement mis en place par l’université de Yale avec des subventions du gouvernement des Etats-Unis d’Amérique, le centre fonctionne désormais comme un institut de recherche indépendant subventionné par plusieurs gouvernements et fondations » et Kofi Annan de recommander la création d’un tribunal international pour juger les crimes des Khmers rouges. Le texte est historique en ce qu’il montre que le procès n’aurait probablement jamais eu lieu sans un lobbying initial qui a émané d’universités américaines ; ce que les historiographes du tribunal évitent bien sûr de mentionner.
De fait, le procès est désormais inscrit comme un fait de l’histoire cambodgienne et ses thuriféraires, dont l’inévitable Youk Chhang, ont subitement découvert l’autonomie de la sphère judiciaire: « ce n’est pas au procès d’écrire l’histoire ». En réalité, le procès n’a été possible qu’au prix d’une réécriture préalable de l’histoire qui se poursuit avec des moyens qui auraient fait pâlir d’envie les fonctionnaires du protectorat français. Il n’y a rien de scandaleux à propos de la parution de l'ouvrage « Histoire du Kampuchéa Démocratique », très largement distribué depuis dans les lycées cambodgiens. L’auteur de l’ouvrage ou le (Documentation Center Cambodia) DCCam sont libres d’exprimer les opinions qu’ils veulent ; ce qui est en revanche à la fois choquant et caractéristique de la situation cambodgienne est la façon dont une officine privée édicte des principes et réussit à les officialiser dans un manuel de lycée qui a obtenu la sanction du ministère de l’éducation. L’affaire ne s’arrête pas là et le lycée Lowell a récemment décidé d’aider le Cambodge en formant des professeurs et en écrivant et publiant un guide d’enseignement à leur attention.
Une histoire imposée ?
La bivalence du verbe (imposer quelque chose à quelqu’un) pourrait suggérer un refus ou une résistance de la part du bénéficiaire ; rien de tel ne s’est passé au Cambodge. A l’époque du protectorat lorsque le Sangha s’est senti dépossédé de ses prérogatives traditionnelles, il y a bien sûr eu des réticences mais qui ont été vite surmontées. L’aisance avec laquelle la culture historico politique édictée par le protectorat a été intégrée est troublante, d’autant plus qu’elle sera très largement emblématique du Cambodge qui suivra le protectorat français.
La réalité est que les catégories de l’histoire du Cambodge conçues par le protectorat français n’ont pas été imposées, mais intégrées sans discussion au sens où elles se substituaient à un vide.
Ce qui beaucoup plus inquiétant est la façon dont l’histoire du Kampuchéa Démocratique est aujourd’hui reconstruite et officialisée par un groupe d’universitaires étrangers pour être enseignée à un public de lycéens sans que personne ne trouve rien à redire. Hors quelques réticences qui portent évidemment sur les questions bien compréhensibles de décompte et d’identification des personnes incriminables, aucun débat de fond n’a eu ou n’aura vraisemblablement lieu.
Peut-on en conclure abruptement que le Cambodge serait la victime éternellement consentante d’une dépossession de son histoire ?
Jean-Michel Filippi